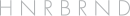
Interview avec ELISE FEDELLI
Télécharger le pdfElisa Fedeli : Vous avez commencé dès l’enfance à façonner de petites sculptures en mie de pain. En 1994, vous avez cessé pour vous consacrer entièrement à la peinture. Qu’est-ce qui a motivé votre passage de la sculpture à la peinture? Que permet la sculpture par rapport à la peinture?
Dès l’âge de cinq ans, une expérience métaphysique avec les objets que l’on trouvait dans les tombeaux à Carthage – où j’ai vécu – m’a conduit à réaliser des sculptures de petit format. La sculpture a donc toujours été chargée d’une force intérieure, en liaison avec la forme d’autisme qui a été la mienne et que suggèrent ces tombeaux. Cette charge est devenue plus lumineuse et plus légère grâce à mon passage à la peinture.
L’agrandissement de mes dessins en peintures a commencé au cours des années 1980. Vers 1994 au bout de 14 années de pratique picturale, j’ai pu assumer ma perception esthétique dans son rapport à une métaphysique de l’objet : mes sculptures ont fait soudain leur apparition dans les peintures à la façon de spectres. Cette transfiguration de la sculpture dans la peinture est venue à moi de façon naturelle, ce n’est pas un effet que je recherchais.
Comment avez-vous conçu la scénographie de l’exposition «Nice to be dead»? On a l’impression que vous avez joué sur une correspondance avec l’architecture des pyramides égyptiennes…
Il y a l’entrée qui évoque le tombeau, puis l’antichambre, la première chambre et, enfin, la deuxième et dernière chambre.
Le mot «scénographie» ne correspond pas à ce que je fais, car il n’y a aucune mise en scène : l’espace ne montre que les murs peints d’un tombeau in situ. Les visiteurs n’ont pas d’ombre de par l’effet de la lumière : existent-ils vraiment ? Ils sont en droit de se poser la question. Ils sont des ombres sans ombre tandis que les peintures sont sur les murs du tombeau : là depuis toujours, elles n’ont aucun besoin de se justifier. Notre présence seule doit être interrogée.
Vos œuvres n’ont ni titre, ni date, ni signature. Elles ont toutes le même format (2,15 mètres) et une facture anonyme. Pourquoi cherchez-vous à libérer la peinture de la présence de son auteur?
J’ai toujours imaginé mes peintures découvertes – pour autant qu’elles devaient l’être – dans une postérité. Pas dans le temps d’aujourd’hui, donc… Une postérité qui aurait perdu la trace et le nom de l’auteur.
A Palerme, il y a deux peintures qui ont pour nom : Le triomphe de la mort. L’une est connue par le nom de son auteur, l’autre, infiniment supérieure, est anonyme. Nul besoin de connaître le nom d’un auteur pour être touché par une oeuvre ! Je ne suis pas en train de dire que les œuvres datées ou signées n’ont pas d’intérêt mais, dans mon univers, il n’y a ni date ni signature.
Comment définiriez-vous le temps que convoquent vos œuvres?
Un temps intemporel : j’espère qu’elles se donnent ainsi.
Vos peintures sont juxtaposées en diptyque ou en triptyque. Cette configuration vous a-t-elle été inspirée par des formes historiques particulières?
Non… Mes pièces ont toujours été juxtaposées : je n’ai jamais pensé une peinture ou une sculpture isolée. Dans mon approche, l’important est la confrontation dans la juxtaposition : l’évocation du mystère que ce dispositif fait naître est au-delà de toute recherche ou compréhension. Qui veut tout comprendre finit par mourir de colère – c’est un proverbe arabe. Le mystère, c’est notre pain quotidien, si je puis dire. En sera-t-il ainsi jusqu’à la fin des temps ? Je l’espère autant que je le pense.
Le premier triptyque confronte trois images: un polyèdre, une sculpture en forme de chaise et une peinture de Gauguin. Cette juxtaposition obéit-elle à une logique (relationnelle, narrative)?
Non, c’est le fruit du hasard. Le hasard de toute juxtaposition. Dans l’idéal, je présente mes peintures sur une ligne continue, sans début ni fin.
Le hasard est le maître d’œuvre de nos destins. Ne pas en prendre la mesure, c’est être aveuglé par notre apprentissage du monde, certainement un manque d’ouverture d’esprit. Il faut laisser le hasard agir et nous guider dans le processus de création.
L’image de la chaise est issue de mon travail sur le tombeau de Julien et Laurent de Médicis. Ce symbole du pouvoir temporel est ici déconstruit et apparait, libéré de son origine, entouré d’un espace d’une dimension métaphysique.
La seconde image est issue de ce qu’on obtiendrait si on appliquait un suaire sur le tableau de Gauguin : une empreinte et une écriture réinventée. Sur l’ensemble de mon travail, les citations, peu nombreuses toutefois, ne s’analysent pas comme une appropriation mais plutôt comme un travail sur l’essence. Qu’est-ce que l’essence? A quel moment elle se perd ? A quel moment il y a rencontre avec une autre essence ?
La troisième image est une tache jaune, non pas un polyèdre. Est notable la manière dont la peinture, à partir d’une simple tache, crée un volume par illusion : ici celui d’un cube. Chaque partie peut être reconstituée mentalement mais se rapproche – par le seul fait de la juxtaposition – d’une pure abstraction. L’intemporel et l’éphémère se donnent toujours comme insaisissables…
Pour dépeindre votre univers, on emploie souvent le terme de «signe», que l’on oppose à celui de «symbolique». Pour vous, que représentent l’un et l’autre?
Gauguin a écrit que la meilleure chose qu’il ait faite est d’avoir tordu le cou au symbolique. C’est une question très importante, qui taraude toute la peinture. L’art n’a rien à voir avec le symbolique. Dès que vous êtes dans le symbolique, vous êtes dans une forme de représentation du monde qui est tout sauf de l’art. L’art, ce n’est ni de la communication ni du symbole : d’un certain point de vue l’art est la non communication même ; il n’est rien d’autre qu’un signe qui, par le seul fait de sa présence, nous laisse sans voix face au mystère. Pourtant il semble qu’aujourd’hui, en dépit de tout, une voie royale s’offre au symbolique. Bon appétit, messieurs, et surtout bonne digestion !
Vos peintures sont toujours réalisées à partir d’un dessin. Où puisez-vous les images qui sont à la source de vos peintures? Quand et comment intervient la transformation?
Je fais beaucoup de dessins et, parmi eux, peu sont agrandis. Pour créer un dessin, tout m’intéresse: photo, dessin, sculpture. Le choix relève d’un processus qui ne fait pas fi du hasard.
Il y a plusieurs passages. J’utilise l’encre de chine, la peinture à l’huile, l’ordinateur, la photographie, etc. Je ne m’interdis rien. Tout m’intéresse.
Le processus d’agrandissement n’est pas un processus créatif, le dessin agrandi étant la reproduction exacte du dessin d’origine. Deux éléments comptent alors: la reconstitution de sa couleur d’origine, obtenue par mélange de toutes les couleurs, et la pose des couleurs sur le tableau en s’aidant de la projection.
Ce système de projection a été inventé par les peintres de la Renaissance. On croit que c’est la photographie moderne, imprimée sur papier, qui a transformé la peinture mais c’est une erreur : la projection photographique – au moyen d’instruments optiques – avait déjà transformé la peinture de la Renaissance.
Dans un diptyque présenté dans l’exposition «Nice to be dead», apparaît une tête esquissée à l’aide de quelques traits gestuels. Pourquoi partir d’un petit dessin pour ensuite l’agrandir mécaniquement, plutôt que de travailler directement à main levée sur la toile?
Certains peintres ont des gestes de création directement sur la toile. A l’opposé, d’autres peintres créent leurs tableaux en petit format puis les agrandissent. Kandinsky par exemple a agrandi sur des toiles de grand format ses dessins de petit format faits à l’encre ou à l’aquarelle. Mes dessins originels sont à peine plus grands que les siens.
Quand vous travaillez sur un format réduit, l’énergie est concentrée et ce qui est obtenu a parfois plus de force, mieux guidé par l’esprit et la main.
Dans le livre Identification d’un absent, un entretien avec Romaric Sulger Büel, on sent un profond désespoir. Vous déclarez que la difficulté à vivre est plus grande que la difficulté à accepter la mort. Pensez-vous, comme Louise Bourgeois, que l’art sert à panser les blessures?
Il faut se méfier de cette approche de Louise Bourgeois. L’art n’est pas un moyen de guérison. Il peut y avoir un rapport entre la liberté, la folie et la création. Mais il faut faire très attention à ce qu’on en dit : cette notion est très subtile, il faut la respecter.
Le texte que j’ai apposé à l’entrée de l’exposition Nice to be dead, fait l’éloge de la différence et du handicap. L’important est de bien comprendre cette dimension de l’artiste. Des écrivains, des artistes et des philosophes ont, certes, sombré dans la folie : il y a évidemment une part de grande douleur et de risque puisque la différence, le handicap ou la maladie sont la source de toute création ou pensée forte. Mais l’artiste trouve la force de vivre sans jamais espérer sa guérison – qui, du coup, serait sa mort annoncée. L’art n’est pas une thérapie ayant pour fonction de guérir son auteur. Pour autant une oeuvre doit être libérée de son substrat pathologique pour entrer dans le champ artistique.
Ce livre d’entretiens, précédemment cité, est empreint d’une profondeur noire. Au contraire, votre peinture est plus légère, presque aérienne. Que pensez-vous de ce décalage?
La peinture est une transfiguration : elle nous mène vers un monde plus léger mais je ne me situe pas dans une forme de transcendance, je me méfie de cette verticalité. J’aime l’horizontalité ancrée dans la réalité de notre monde. Mon approche est pure poétique : le mystère même s’il est appelé d’un point de vue métaphysique n’est en aucun cas l’évocation d’un autre monde qui serait différent de celui-ci.
Vous avez toujours été réticent à l’idée d’exposer. Peut-on dire que la reconnaissance ne vous intéresse pas?
J’ai eu celle des artistes. Aujourd’hui le public est appelé à donner son avis. Cette reconnaissance, en avais-je besoin ? Bizarrement non, j’existais par moi-même, avec mes propres repères, sans le regard des autres. Mais maintenant je ressens un plaisir étonné : oui, la façon dont les peintures sont reçues par le public m’étonne et me plait.
Quels artistes, parmi vos contemporains, vous intéressent?
J’ai beaucoup d’amis artistes et je ne vais pas répondre à cette question en vous donnant des noms (rires)!
Je peux simplement vous dire qu’aucun d’entre eux ne donne dans le pathologique, le morbide ou la pataphysique.
Les artistes qui fonctionnent de façon mentale, sans vouloir tout expliquer du monde par leurs créations, ceux-là, je les aime.
Lire:
Henri Barande, Identification d’un absent, Manuella Editions, 2008.
Par Elisa Fedeli
Le 7 avril 2011

- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH
- Interview avec MEDIAPART
- Interview avec ELISE FEDELLI
- Interview avec JEAN-PAUL BATH