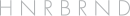
Comme l’église de Balbec pour Proust, cette œuvre est emplie de signes dont aucun ne saurait être retranché. Elle s’exprime dans l’évidence du fragment, chacun fonctionnant comme totalité en réserve et s’offre à être lue sans début ni fin, ni chronologie. C’est une des raisons pour laquelle l’artiste n’entend pas se défaire de ses peintures. Elles sont un ensemble, un opus.
Cette peinture naît d’un travail d’excavation pour l’extraire certes de la gangue du passé, mais surtout pour la re-contextualiser, la re-situer, lui dire le lieu vrai. Le paysage d’enfance de cet artiste fut Carthage, ses ruines, ses mosaïques, ses tombeaux, un site où les cultures successives furent en continuelle réécriture. Ses peintures, impressionnées par la proximité de civilisations disparues où vie et mort se répondent en jumelles magies, interrogent ces mêmes lieux avec un art à la fois dé-matérialisé et incarné — un art vivant comme le clamait Courbet.
Le flux incessant des images ayant épuisé notre faculté de les appréhender, l’ici et maintenant ne sont plus perceptibles dans une stabilité qui est le propre de leur nature : le lien de solidarité avec le réel s’est dissous. Les peintures auxquelles nous sommes confrontés ici sont des no man’s land, des no times’s land, des espaces virtuels où la vie et son apparence spectrale sont sur scène, se répartissant l’espace. Elles dévoilent un chaosmos, selon un précis néologisme de James Joyce.
Les figures, les paysages, les objets, les formes sont placés au centre de la toile en état d’apesanteur sans ombre ni perspective, sans illusion d’un espace perspectif. Le point de fuite est placé vers le spectateur dans une perspective inversée : l’image vient à lui, le fond et la figure sont saisis dans une même vision. Les peintures sont dans une équivalence fonctionnelle, aucune date, aucun titre, aucune signature. Elles nous apparaissent empreintes de lumière, comme nées d’une insolation d’énergie. Le peintre, note Deleuze, n’a pas à remplir une surface blanche, il aurait plutôt à vider, désencombrer, nettoyer.
Chaque exposition est éphémère, juxtaposant les peintures en ligne continue parfois en diptyque, triptyque, polyptyque. Leur agencement, est toujours à réinterpréter comme une partition musicale avec ses résonances aléatoires. Les polyptyques sont enjeux de rythme et interdisent toute narration : ils résistent ainsi, et c’est leur force, à tout accord juste de sens, préservant l’évidence de l’accident. Il n’y a donc aucune place pour de quelconques périodes où s’afficherait une progression qui serait décelable. Il n’y a ni début ni fin : c’est une œuvre sans repère, non-repérable – une œuvre en réserve.
Ce créateur ne nomme pas : il retire aux images leur origine, leur nom, il les dénomme comme on dénude un corps. Il rend anonyme chaque sujet, il anonymyse. On devrait pouvoir écrire ce verbe pour sa peinture et pour lui-même. L’échec de toute image à représenter un sujet le retient dans sa recherche, un autre lien avec l’univers de Marcel Proust.
Il pénètre dans toute image, toute peinture comme dans un mausolée sans gardien. Sans geste iconoclaste, il cherche l’aura des tableaux et leur surface d’effacement. Il redonne du temps au temps de l’œuvre par un travail préparatoire qui sera de l’ordre du différé, du différent à faire surgir lors de la transposition sur la toile. Peintre de la couleur, il cherche pour chaque toile le sentiment d’infini. En cela ses peintures ont l’hiératisme des Color-Field de Barnett Newman et la densité silencieuse et infinie de celles de la période dite classique de Mark Rothko.
L’atelier de recherche, c’est la chambre noire, celle de l’artiste — de l’écrivain pour Proust. La métaphore de la chambre noire donne à saisir le lieu de la fabrication de toute oeuvre. Henri Barande travaille le point de déflagration, de déstructuration de l’image qui lui sert de trame, de support pour en atteindre le cœur. C’est ce point où la figure se défigure où l’image ne renvoie qu’à elle. Le peintre a pour cela ses outils contemporains, comme Vermeer avait le sien : des machines optiques.
Si Henri Barande réalise des milliers de dessins, lavis, empreintes, photos, il n’en prélève que certains qu’il transpose en peinture en les agrandissant. La fragilité du dessin d’un portrait – ou de celui d’une mouette – réalisé dans l’économie des moyens d’un trait fluide d’une encre brune, se découvre, reproduit et agrandi, avec une extrême précision et magnifié dans le silence de la peinture. Par elle, il prolonge et réinvestit son travail de sculpture : dés sa rencontre avec les ruines de Carthage, à l’âge de 5 ans, il modèle en effet une matière faite de mie de pain, de sable, d’algues et de terre. Le matériau utilisé de par sa fragilité de conservation fut pour lui une matière à manipuler, presser, couper, usant de la tactilité de ses seuls doigts et de ses ongles comme couteaux. Comme pour le dessin, c’est l’immédiateté qui importe.
Par la peinture et son changement d’échelle, il continue le travail de métamorphose de l’objet entrepris avec la sculpture.
Là la main est la matrice visible, mais dans la peinture la trace manuelle disparaît. Certes, elle est peinte de main humaine, mais d’une main invisible : c’est une facture quasi mécanique qui apparaît, d’où la finesse de leur surface tactile. Ce serait à tort toutefois qu’on rapprocherait ces peintures de celles des hyperréalistes car elles ne sont pas issues de la re-duplication du réel à partir d’un autre médium reproductif. La photo n’est ni modèle, ni sujet : elle n’est qu’un support, une grille de lecture, aucune des œuvres n’ayant une apparence photographique. Henri Barande redonne à l’image son hallucinante irréalité pour nous mener à la quête des correspondances dans l’aléatoire de l’apparition des signes.
Ces infinis perçus, entr’aperçus, écoutons la peinture avec nos yeux et aussi notre corps, les étoiles tournent rond.
ERIC CORNE,
Paris, 2010.