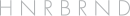
On se souvient peut-être des derniers mots de L’œil et l’esprit de Merleau-Ponty, des mots par lesquels le texte, au point de s’achever, dit et sans doute rencontre l’inachèvement fondamental à l’œuvre de création : « Car si, ni en peinture, ni même ailleurs, nous ne pouvons établir une hiérarchie des civilisations ni parler de progrès, ce n’est pas que quelque destin nous retienne en arrière, c’est plutôt qu’en un sens la première des peintures allait jusqu’au fond de l’avenir. Si nulle peinture n’achève la peinture, si même nulle œuvre ne s’achève absolument, chaque création change, altère, éclaire, approfondit, confirme, exalte, recrée ou crée d’avance toutes les autres. Si les créations ne sont pas un acquis, ce n’est pas seulement que, comme toutes choses, elles passent, c’est aussi qu’elles ont presque toute leur vie devant elles.» (i). Cette condition de décomplétude (ii) et pour ainsi dire d’impossible acquittement – si achever en effet c’est être ou se penser quitte du monde et de soi – constitue la leçon si singulière que l’oeuvre de Henri Barande porte en elle. Une leçon qui l’engage à la discrétion, à cette forme de discrétion qu’est pour Blanchot la conscience du dessaisissement et de l’inappropriable. Nulle peinture n’achève la peinture. Mais toute peinture ou toute œuvre, comme le dirait sans doute Henri Barande, fait de cette condition sa possibilité et l’exercice d’une liberté. Si la peinture commence par s’inachever, si elle est décomplète depuis son avenir, en dépit d’une fin tant de fois proclamée, son expérience n’inscrit-elle pas dans le temps comme dans le lieu, un sillage d’indétermination, ne dessine-t-elle pas invisiblement une ligne d’inacquittement qui est aussi une ligne de force ?
C’est une telle intuition qui oriente cette oeuvre depuis le moment de sa découverte et sous les deux visages qui sont les siens: l’un enfoncé dans l’ombre, composé d’objets façonnés dans une matière brute et périssable, l’autre, exposé à la lumière qui épouse le plan du tableau et ses figures apophantiques. L’art d’emblée, pour regarder la vie, assume une valeur anamnésique qui s’origine dans l’expérience pure de la création. À l’âge de cinq ans, la vue d’un fragment exhumé inspire ses premières ébauches de sculptures formées d’un mélange de sable, de terre et de mie de pain. « Ces fragments de force contenue, » écrit-il, « issus de mes doigts ou ceux ramassés sur le sol parce que mon œil les saisissait, étaient de même format que les têtes peintes des colliers puniques. Ce qui était fascinant dans ce geste, c’était qu’il fut créateur de formes différentes, souvent plus archaïques que celles auxquelles j’avais accès. » (iii) La confection irrépressible de sculptures a coïncidé avec l’intérêt pour les objets trouvés sur le sol, et sous le sol: à savoir la découverte du mystère et de la puissance des objets sur les sites archéologiques de Carthage où il a passé son enfance, en particulier lors d’intrusions dans le Tophet, un cimetière punique que les Romains avaient «éradiqué» en le couvrant d’une voûte. Un trou dans la voûte, se souvient-il, donnait accès à l’obscurité sépulcrale de ce lieu où il découvrit l’énergie mystérieuse d’objets qui semblaient communiquer entre eux, en même temps que la tension entre une culture dominante et celle qu’elle écrase. Sa fascination pour les vestiges de civilisations disparues et leurs objets votifs ou cultuels l’amenèrent à se passionner pour les cultures anciennes, et à leur exhumation sur divers sites archéologiques. La terre, selon lui, « reste le plus ancien musée du monde et ses trésors ne sont pas tant enterrés que sublimés. » (iv)
Le façonnage de milliers de sculptures, sur plusieurs décennies (Fig 1.1) prit fin avec le projet de soustraire définitivement à la vue ses créations « de nature autiste »(v), en les enterrant ou les détruisant. L’autodestruction en art n’étant jamais seule destruction (vi), l’artiste en 1994 privilégia leurs traces spectrales et les fit apparaître dans sa peinture, tout en préservant certains ensembles intensément poétiques, abrités toutefois de la vue par leur recouvrement. L’espacement intime qui lie les deux versants de l’œuvre appelle une réflexion sur ces configurations nommées par lui « tombées hors du temps » ou « tombeaux ».
Les ressemblances inchoatives
Des ensembles de choses et de sculptures, façonnées ou prélevées par l’artiste, instaurées ou seulement accueillies par le regard – un regard qu’alors ou qu’à leur tour elles objectent – Derek Pullen a pu dire qu’ils s’inscrivent dans la tradition des Wunderkammern (vii). L’analogie est séduisante mais elle s’avère trompeuse, s’agissant ici non de collection mais de créations et de mise en correspondance avec la nature. (viii) Ses sculptures de petits formats y côtoient de menus objets naturels : fragments de pierre et de coquillages, écorces, élastiques entortillés, plaques de marbre, cristaux de roche, figurines en opale ou en ivoire. (Fig.1.2) Dès lors qu’il se rend attentif aux effets de juxtaposition, de répétition et d’analogies, le regard touche au principe fondamental ici à l’oeuvre, celui reliant les formes façonnées aux objets achéiropoïètes, et les unes et les autres aux tableaux eux-mêmes, un principe qu’avec Dario Gamboni l’on peut qualifier d’image potentielle. Qu’elle soit en effet en puissance ou en condition de possibilité, l’image potentielle manifeste une dimension inchoative qui exige la participation active et subjective du regard. Elle relève elle-même de la catégorie plus large de l’image double – une image que l’on peut voir de deux manières différentes – au même titre que les images naturelles formées dans les nuages ou dans les pierres, les images composites ou réversibles, les crypto-images ou images cachées. Mais à la différence de celles-ci qui s’offrent immédiatement au regard ou qui, une fois perçues, demeurent stables, elle demeure latente et son actualisation dépend du regardeur (ix).
Dans cette oeuvre, les configurations et les voisinages eux-mêmes sont facteurs d’image (Fig.1.3) Soit la juxtaposition d’une simple pierre glanée et d’une petite sculpture de forme ovale, pétrie dans un mélange de mie de pain mêlée à de la terre, dont une excroissance et quelques incisions figurent le nez, la bouche et les yeux. L’efficace de cette proximité invite à regarder la pierre minuscule comme un profil, aux lèvres parfaitement dessinées, au nez saillant, à la pommette bombée et à l’œil rond. C’est encore l’association de deux têtes sculptées qui conduit à voir dans un marbre poli couleur chair un torse archaïque. Ailleurs l’assemblage suscite l’anthropomorphisme : une racine et un fragment minéral, une pierre et un coquillage rose lustré par les vagues se transforment en personnage ou en guerrier antique. (Fig.1.4; Fig.1.5) Certains objets d’apparence modeste s’avèrent d’une grande complexité visuelle. Un simple bout de racine se révèle capable de susciter une série d’aspects. (Fig.1.6) Les boursouflures du bois et de profondes fissures dessinent les yeux, la bouche, le nez ; sur ce masque se greffe comme un lichen séché le profil d’une créature hybride mi-félin, mi-satyre. Moins image double que poly-icône, la racine engage d’autres métamorphoses, quelque corps surmonté d’une tête voilée : une coquille de nacre aux stries élégantes. Le visage qui se tient entre figure et défigure, entre objet trouvé et artefact, entre image accidentelle et image sculptée, donne tout son sens à l’idée d’ambiguïté définie par l’appartenance à deux catégories (que désigne le préfixe latin « ambo ») et par l’effet inquiétant que provoque l’indéterminé. En écho, un portrait sculpté dans une matière composite fait planer le doute sur la frontière poreuse entre image naturelle et artefact. (Fig.1.7) Un obélisque phallique en cristal de roche, une double image réversible japonaise sculptée dans l’ivoire, des plaques de marbre évoquant les paesines et dendrites rappellent encore la fascination ancienne pour les images de la nature ou le goût pour les racines et les pierres de rêve des lettrés chinois. (Fig.1.2; Fig.1.8) La présence d’un petit cube bleu prend ici une valeur d’emblème. (Fig.1.9) On peut le voir alternativement avec une face antérieure en haut à gauche et une face antérieure en bas à droite, selon une oscillation optique révélée dans l’aspect. Un « voir comme » disait Wittgenstein, qui « ne rentre pas dans la perception » mais dans ce qui la recouvre, « moitié expérience visuelle, moitié pensée ».(x) Les images potentielles dissimulées dans l’oeuvre de cet artiste nous amènent à travers l’expérience de la bistabilité perceptive à éprouver une phénoménologie originaire de la vision et posent la question fondamentale de la part de pensée ou d’interprétation qui accompagne en effet la perception. L’archaïsme des formes y rejoint l’archaïsme de la reconnaissance des formes.
Dès la Renaissance en effet, la perception imaginaire a été reliée aux origines de l’art :« En examinant un tronc d’arbre, une motte de terre et d’autres objets du même genre, écrit Alberti, on a dû un jour remarquer certains traits qui, légèrement transformés, pouvaient ressembler tout à fait à de vraies figures naturelles. » (De Statua, 1430) (xi) L’idée que la première œuvre d’art vient du dehors, de la nature elle-même, et du désir de compléter les ressemblances inchoatives qu’elle offre a donné lieu à de nombreuses spéculations chez les artistes et les théoriciens depuis lors. Le « réalisme fortuit » que la science naissante de la préhistoire associe aux représentations d’animaux épousant la configuration irrégulière des parois des cavernes paléolithiques, reformulera en quelque sorte l’hypothèse d’Alberti. La découverte en 1925 d’un galet anthropomorphe a notamment suscité de nouveaux débats non seulement sur la question des origines de l’art mais aussi de la perception des images. (Fig.1.11) L’objet qui ne montre aucun signe de modification délibérée est interprété comme le plus lointain témoignage non d’une image produite mais perçue par l’homme, trouvée puis transportée loin de son lieu d’origine en raison de sa ressemblance accidentelle avec un visage et de son saisissant « regard ». On rapprocherait volontiers le galet de Makapansgat des têtes archaïques sculptées de Henri Barande (Fig.1.10; Fig.1.12), ou encore cette tête de coyote sculptée dans une vertèbre de lama (-12000 av. J.-C.) (Fig.1.13) de son osselet « tête de singe». (Fig.1.14) Il n’est pas non plus sans incidence et d’abord sans raison que l’osselet singe et la tête fortuite rappellent les sculptures de Picasso et de Giacometti, comme les têtes puniques auxquelles elles ressemblent.
L’aléamorphose ou image accidentelle se retrouve aussi au cœur de l’œuvre picturale d’Henri Barande. Quatre taches rouges iridescentes jetées sur une feuille comme par le jeu du hasard suggèrent le plastron d’un d’insecte que prolongent de fins tracés en guise d’antennes et de pattes. (Fig.1.15) Ailleurs, l’eau lancée « à l’assaut des pigments, qui se défont, se contredisent, s’intensifient » (xii) fait surgir un corps dansant à tête de crâne. (Fig.1.16) Plusieurs dessins d’images potentielles sont transposés dans les peintures, parmi lesquelles une tête embryonnaire et une extraordinaire mouette qui émergent de la confluence magique du pigment et de l’eau, semblant apparaître à même le processus de leur disparition. (Fig.1.17; Fig.1.18). Un fluide paysage diagrammatique se révèle être un profil, une ruine de tête rendue à la terre. (xiii) (Fig.1.19) Aussi bien, les toiles transposent-elles les ressemblances inchoatives des « tombées hors du temps ». La sculpture dont l’une des faces est marquée par l’image cruciforme d’un visage potentiel (Fig.1.20) – ne sont-ce pas là des yeux, un regard et la structure de toute visagéité ? – a donné lieu à une interprétation picturale (Fig.1.21). Une reprise et une mutation : en déplaçant le champ matériel d’apparition, l’artiste en transforme l’éventualité et l’événement. Peint en couleur dorée sur un fond pourpre, la forme conjuguée de heaume et de sarcophage, délestée de sa compacité première, est transfigurée dans l’image fantasmatique d’un envol. Le lieu de l’enfouissement et de la mort tout à l’heure envisagée sinon visagéifiée rencontre, au plan du tableau, la figure infiniment légère mais souveraine d’un battement d’ailes. En faisant à nouveau accéder à la visibilité les objets détruits ou enfouis, Henri Barande les métamorphose en un corps pictural. Le minuscule entrelacs d’élastiques évoquant un torse (Fig.1.2) semble avoir inspiré plusieurs images potentielles peintes comme de juste sur le principe de l’entrelacs. On discerne par exemple – mais toujours s’agit-il de voir comme – un crâne fantomatique aux yeux hallucinés dans les lacets d’une ligne ponctuée de taches fluorescentes (Fig.1.22; Fig. 1.23). En d’autres toiles, en d’autres rêts, en d’autres tracés ou pointillés (fig.1.24.; Fig. 1.25), la figure du crâne continue de s’inviter, sans cependant s’objecter ou s’indéterminer de la même façon ni au même degré. Ne faut-il pas reconnaître en ce lieu, en ces cas, mieux que l’emblématique rappel au terme et à la vanité de toute chose, le nouage incessant de ce qui apparaît pour ainsi dire absolument dans le tissu de son apparition, entre le motif d’une obviation – obvier la mort ? – et l’évanescence de l’image elle-même. Un moment en somme, car il y va en effet du temps, où la peinture se réfléchit dans ce qui n’est plus donné d’imaginer comme tel. À ce titre encore – à cette absence de titre – tableaux peints et sculptures se regardent. L’image potentielle est ce qui relie les deux lieux de l’œuvre de Henri Barande que sont la sculpture et la peinture. L’indétermination peut bien mener jusqu’à la dilution, le jeu entre apparition et disparition qui gouverne les ressemblances potentielles entre alors en résonance avec le processus pictural lui-même, depuis l’oblitération des sculptures –détruites ou enfouies – jusqu’aux traces de leur inscription spectrale sur le « linceul de la toile ». (xiv)
Les images potentielles se définissent par leur caractère fondamentalement instable et métamorphique dont rend compte le terme d’oscillation souvent évoqué à leur propos. Elles trouvent un écho dans la définition que donne Bachelard des images instables et fugitives de l’imagination aérienne qui « s’évaporent ou se cristallisent » et qu’il faut saisir « entre les deux pôles de cette ambivalence toujours active » (xv). Établies en puissance par l’artiste mais dépendant pour leur actualisation du spectateur, elles ont pour effet de rendre ce dernier conscient du caractère subjectif de la vision.(xvi) Cette dimension autoréflexive caractéristique de l’image potentielle, cet artiste la partage avec nombre d’artistes aujourd’hui, de Jasper Johns à John Stezaker, et elle le rattache à une longue et riche tradition picturale (xvii), avec ceci de nouveau que les toiles de Henri Barande ne sont jamais seules. Leur présentation systématique par paires ou par séries implique que la perception d’une toile subit toujours l’influence de celles qui la jouxtent. Cet effet, qui n’est pas loin de celui que Koulechov avait théorisé pour l’image filmique, se répercute également entre images distantes dans les phénomènes d’échos visuels favorisés par la ligne continue de leur présentation. Ainsi, la perception d’images potentielles dans plusieurs tableaux invite-t-elle à la reconnaissance de virtualités plus implicites dans d’autres. Le grand portrait féminin par exemple (Fig.1.26), dont la partie harmonieuse du visage semble se défaire dans la masse informe de la chevelure qui lui fait pendant, visualise la tension entre figure et défigure caractéristique des images potentielles. L’effet de solarisation inversant les valeurs, l’étirement démesuré et le rendu presque organique installent une inquiétante étrangeté dans l’image peinte d’un gilet à capuche s’étalant sur trois mètres de large. (Fig.1.27) La position horizontale et l’indétermination de l’image invitent à basculer le regard pour identifier la nature de l’objet représenté. La capuche coïncide alors avec une tête émaciée qui fait écho à celles que, de Dürer à Delacroix ou Bonnard, les peintres dissimulent dans les plis instables des coussins ou dans les draps de quelque lit défait. En d’autres tableaux, l’inchoativité s’apparente à une ruine que le regard s’efforce de compléter, sans toutefois y parvenir. Dans un vaste paysage (Fig. 1.28), la figure lacunaire d’un taureau est environnée d’ombres diluées en taches et en points, de latences visuelles que le regard porté à l’attention flottante conjugue en formes sans noms, labiles et indiscernables.
L’image mosaïque.
Le parti pris initial d’une hauteur de format identique pour toutes les toiles – 2,15 mètres pour une largeur qui varie de un à plusieurs mètres – garantit un effet d’homogénéisation des images dont les mobiles, les sources et les thèmes sont cependant variés : portraits sculptés et objets issus des « tombeaux », dessins, photographies prises par l’artiste, se mêlent aux œuvres revisitées de l’histoire de l’art. Selon une logique libre de tout déterminisme, la peinture de Henri Barande fait se côtoyer la Vierge allaitante de Jean Fouquet ou le Portrait de jeune femme de Petrus Christus avec les nus de Gauguin, les chevaux préhistoriques de la grotte Chauvet avec la Cène de Léonard de Vinci, les images figuratives issues de photographies et les images abstraites, les compositions informelles et les abstractions géométriques. Mais l’homogénéisation n’est pas tant assurée par le format que par la séquence opératoire à laquelle sont soumises les images sources. Elles sont l’objet d’un premier traitement numérique qui les porte aux limites de la reconnaissance et au seuil de l’abstraction. L’agrandissement à l’extrême d’une photographie de paysage (Fig.2.1) en disloque littéralement l’apparence pour donner à voir les rudiments, traces lacunaires ou points à quoi elle se ramène. Ces coordonnées fantomatiques sont ensuite matérialisées dans la texture pigmentaire du tableau. La migration de l’image photographique dans l’espace du tableau conduit à des peintures de type hybride, des « peintures photogéniques » selon l’expression de Michel Foucault,(xviii) et, à cet égard, Henri Barande s’inscrit dans le sillage des peintres qui de Richard Hamilton à Gerhard Richter ont privilégié la pratique des médiums mixtes, mais ses peintures s’en distinguent cependant par une hybridité accrue, mêlant les régimes optiques du photographique, du numérique et du pictural, soumettant aux opérations d’agrandissement, de solarisation, de pixellisation, objets et images provenant de cultures et d’époques diverses, des plus éloignées aux plus récentes.
Les processus engagés assurent à cette oeuvre l’une de ses caractéristiques formelles les plus saisissantes: sa mise en oeuvre mosaïque. En premier lieu, le terme désigne on le sait un assemblage fait de petits cubes ou fragments multicolores de matériaux divers formant une figure qui pare un sol ou un mur. C’est bien en ce sens que de nombreux tableaux – vaste paysage (Fig. 2.2; Fig. 2.3), portrait, nu féminin (Fig.2.4; Fig.2.5; Fig.2.11) ou composition abstraite (Fig.2.6), sans parler d’images elles-mêmes fragmentaires, tels les animaux figurés de la grotte Chauvet (Fig.2.7) – utilisent ou plutôt subliment en peinture la partition en tesselles de la mosaïque.(xix) À l’homogénéisation formelle et technique de thèmes disparates s’ajoute une tension temporelle qui a trait à la valeur de durée associée à la mosaïque, « véritable peinture faite pour l’éternité »(xx). Elle confère au nu féminin peint à partir d’une photographie (Fig. 2.8; Fig.2.9) l’apparence conjuguée d’un nu de Bonnard et d’une verseuse d’eau des mosaïques de Carthage, qu’elle associe encore, non sans paradoxe, aux images pariétales des premiers artistes. Réunion de l’un et de l’hétérogène et stratification temporelle renvoient à l’un des traits fondamentaux de cette oeuvre: l’impossibilité de voir ou d’interpréter isolément les tableaux constamment unis les uns aux autres et dépendant, aux différents niveaux où elle s’applique, de la relation parcellaire dont la mosaïque est l’image non moins que l’opération. Une image dès lors transhumée, pour reprendre le terme de Foucault, que l’on peut en effet considérer comme totalité ouverte sur l’hétérogène.
Il n’est pas sans vertu, depuis la peinture de Henri Barande, de considérer comment le medium mosaïque, « tout en morceaux, objet à facettes »(xxi), instaure une tension fondamentale entre les deux pôles de l’unité de l’ensemble et de la discontinuité de ses composants, propre à relancer dialectiquement le regard. (xxii) Le rapport mosaïque des parties constitutives au tout, définit une situation d’oscillation visuelle qui a pu paraître problématique; de fait son histoire est marquée par la dévaluation du point de vue fragmentaire au profit du point de vue unitaire, l’hétérogénéité étant vouée à se fondre dans l’homogénéité, le fragment à se soumettre au tout. Le point de vue unitaire fut théorisé dès les premiers siècles du Christianisme par saint Augustin qui, dans son traité « De l’ordre », spécule sur la vision par l’homme des objets de la nature assimilable à la vision d’une mosaïque. Il y fustige la vision myope de ceux qui ne percevraient dans les fragments qu’un mélange dépourvu d’ordre, incapables de discerner simultanément l’image qui les subsume.(xxiii) Le point de vue de l’unité exposé par saint Augustin, familier dès sa jeunesse carthaginoise des mosaïques gréco-romaines, est celui qui va dominer l’histoire du medium. Mais l’intérêt de ce texte tient avant tout à ce qu’il met en évidence le lien fondamental unissant vision et technique mosaïque, en d’autres termes, par le point de vue qu’elle instaure, la pensée visuelle dont celle-ci témoigne. À la différence de la mosaïque sur laquelle on marche dont parlait saint Augustin, propice à l’oscillation du regard entre le détail fragmentaire et la vision d’ensemble, la hauteur où les mosaïstes byzantins ont placé le Christ d’Hagia Sophia à Constantinople (Fig.2.10), soustrait à la vision la discontinuité des tesselles au profit d’un point de vue unifiant, intensifié par un effet visuel spécifique. Deux teintes juxtaposées et perçues à une certaine distance produisent dans l’œil une troisième couleur. Le mélange qui s’effectue dans la perception de l’œil – comme le redécouvriront l’impressionnisme et le pointillisme – garantit à la couleur de la mosaïque une luminosité plus grande que celle produite par le mélange pigmentaire. Dès lors, éloignement visuel, luminosité du mélange optique et utilisation du fond d’or contribuent ensemble à conférer au visage mosaïque du Christ une aura de vision spirituelle qui préfigure la vision béatifique eschatologique.
En raison de son principe de discontinuité, la mosaïque a été progressivement discréditée pour laisser la place à la peinture et à la fresque plus conformes aux idéaux esthétiques renaissants de l’unité de la forme et de la narration. Et lorsque le sens figuré de la mosaïque est attesté dans la langue à la fin de la période classique comme « ensemble composé d’éléments disparates »(xxiv), c’est bien le sens péjoratif de la discontinuité qui est mis en avant. Rien de surprenant donc à ce que, après une longue période de désaffection, l’art moderne réhabilite les propriétés et l’usage de la mosaïque en tant que telle(xxv), mais aussi, à travers elle et au-delà, les valeurs heuristiques de l’incomplétude, du fragment et de la matérialité de l’image partitive.(xxvi) De la peinture de Cézanne au pointillisme de Seurat, du cubisme aux papiers collés, et jusqu’aux combine paintings de Rauschenberg, le moment moderne est dès lors celui où s’inverse le rapport de l’unitaire au fragmentaire hétérogène, dans la tension maintenue visible entre les parties et le tout.(xxvii) Ce n’est pas seulement l’ordre des choses qui est remis en question, mais bien l’ordre des causes et des « raisons »(xxvii) qui sont reconsidérées au profit du fragmentaire et de l’ouvert.
Compris et plus encore éprouvé au double niveau de l’instance et de l’opération, le principe mosaïque anime la pensée visuelle de Henri Barande. Ainsi structure-t-il le grand paysage bleu peint sur un fond gris léger. (Fig.2.2) La composition est marquée par une lisière dessinant une courbe qui s’incurve légèrement vers le bas sur les deux bords et séparant l’image en deux moitiés. On devine une zone de clairière dans la partie basse tandis qu’un rideau d’arbres obstrue la moitié supérieure. En même temps les larges interstices de gris attirent le regard vers le détail des tesselles aux subtiles nuances de bleu, allant du clair au foncé, devenant ponctuellement blanches, faisant alterner les aplats et les pentagones cernés d’un trait sombre (Fig.2.12), le tout produisant une sensation de vibration, forçant l’oeil à osciller incessamment entre le proche et le lointain, la surface et la profondeur, l’unité du paysage et son éparpillement fragmenté, la figuration et l’abstraction. Le principe mosaïque agit également si l’on considère cette fois la tension entretenue entre le tableau comme fragment et les liens qu’il tisse avec celui qui lui est juxtaposé et tous ceux qui lui font écho au sein de la ligne continue, infinie, virtuelle et mentale dont Henri Barande a la vision. En l’occurrence, la mosaïque du grand paysage bleu est mise en relation avec la ressemblance inchoative du tableau directement juxtaposé : un entrelacs bleu et rose sur fond blanc y assume dans sa fluidité même l’image déliquescente d’un crâne. (Fig.2.13) En vertu de cette contiguïté, un va et vient visuel s’instaure de l’un à l’autre des tableaux perçus comme « fragments » de l’ensemble, chacun formant une unité, mais ouverte, reliée au tout. Ainsi la juxtaposition du crâne indéterminé et du grand paysage bleu nous entraîne-t-elle à voir comme image potentielle la zone sombre qui en occupe le centre: à y reconnaître une silhouette vue de dos regardant vers la forêt, si ce n’est le reflet ou l’ombre portée du spectateur dans l’image. Et c’est encore par le jeu mosaïque de tension entre le fragment et le tout que l’œil repère semblable disposition dans un autre paysage également soumis à parcellisation. (Fig.2.14) Un paysage qui n’en a pas moins l’agencement solide des grands tableaux classiques : la ligne d’horizon sépare l’avant-plan obscur des lointains plus clairs, coupée par la verticale de deux arbres aux troncs et aux feuillages ombrés. Ici derechef, une forme sombre occupe le centre du paysage. Une forme indéterminée ou potentielle en laquelle le regard alerté et attentif peut reconnaître un portrait. Sur la gauche, un liseré dessine les contours d’une épaule et d’un cou, puis l’ovale d’un visage – en l’occurrence celui du fils de l’artiste se reflétant sur une vitre dans une photographie métamorphosée en peinture.(xxix) Ici comme là, le battement incertain de la silhouette – absente et présente, de dos et faisant face – fait écho au spectateur, dont il trouble la vision, comme il joue et déjoue la métaphore classique de la surface-image transparente. Dans une telle configuration, emblématique à bien des égards, les liens produits entre structure mosaïque, image potentielle et vision se trouvent objectivés sinon thématisés.
D’une part, l’effet d’apparition – disparition fait écho à l’oscillation qui définit l’image potentielle, qui se tient entre « évaporation et cristallisation ». D’autre part, la mise en oeuvre ou la thématisation du regard se répète dans ses toiles, et les regarder c’est être regardé. Regard frontal des nus féminins ou d’un Kamikaze qui nous dévisagent (Fig.2.15; Fig.2.16), regard intensifié par la couleur, d’un singe ou d’un portrait en entrelacs. (Fig.1.22; Fig.2.17) Ces regards insistants appartiennent à la tradition picturale du regard qui interpelle le spectateur et implique un échange dynamique entre celui-ci et l’image. Ils contribuent, avec la frontalité et l’ampleur du format, à créer un vis-à-vis avec le spectateur. De manière significative, la thématisation scopique inclut aussi les effets d’obstruction et d’aveuglement. Les lunettes de Marguerite Duras, d’après un portrait sculpté transposé et magnifié en peinture, se transforment en masque aveuglant. (Fig.2.18) Les yeux de la jeune femme d’après Petrus Christi sont embués d’une poussière argentée qui rappelle la neige brouillant les écrans. (Fig.2.19) Le regard de l’Ophélie allongée, qui vue de loin nous fixe intensément, se dissout de près en taches informes faisant coïncider vision et aveuglement, beauté irradiante et inquiétante défiguration. (Fig.2.20) Plus que tout autre, le monumental portrait féminin au regard oblitéré prend ici une valeur emblématique. (Fig.2.21)
À travers la « figure filtre »(xxx) et le motif du regard entravé ou voilé, le tableau obtient la thématisation de sa propre logique mosaïque tendue entre visée imageante et visée perceptive, unité et fragmentation, transparence et opacité.
La grande image n’a pas de forme.
À la ressemblance inchoative et à l’image mosaïque, s’adjoint dans la peinture de Henri Barande un principe – contenu en germe dans le geste répété sans fin des milliers de portraits sculptés, visages sans noms aux traits indéterminés, s’actualisant sans jamais s’arrêter à une ressemblance singulière – que l’on pourrait rapporter à ce que le philosophe François Jullien nomme « variance ».(xxxi) À savoir, la capacité d’une image à ne pas privilégier un axe, un aspect, mais à laisser les différents aspects juxtaposés, à maintenir ensemble « toutes les approches possibles dans une égalité de principe ». (xxxii) Ce qu’il explicite en liant le concept de variance à celui de compossibilité (xxxiii) désignant la nécessité de faire le tour de tous les aspects sans qu’aucun ne soit privilégié.
Cette multiplicité des possibles, le Laozi, le plus célèbre traité de la peinture chinoise, en a donné la formule la plus concise : « La grande image n’a pas de forme. »
Ce que nomme ici la grandeur, selon François Jullien, c’est la compossibilité de l’image, sa capacité à contenir tous les possibles en ne se réduisant pas à un aspect particulier mais en tenant tous les possibles à égalité. La ressemblance n’est pas exclue, mais elle reste ouverte parce que ne privilégiant aucun trait exclusif. C’est pourquoi, parallèlement au compossible, la modalité foncière de la grande image est celle de l’évasif et de l’indéterminé, du flou. ( xxxiv) Non pas le flou cantonné à la seule représentation des lointains ou qui serait simplement l’effet du désordre ou de la confusion, mais le flou ouvert de l’inchoatif, celui évanescent laissant apparaître et disparaître, maintenant les choses dans l’évasivité, au seuil du perceptible. (xxxv) « Peindre sera donc peindre cette forme-ci – singulière comme elle est – mais sans entrer dans la dépendance de cette forme. » (xxxvi) Tout se jouant dès lors dans la tension, d’une part, entre la forme concrète sans laquelle la grande image ne peut exister, et de l’autre, l’absolu abyssal, la transcendance vers laquelle tend l’image concrète sans pour autant qu’elle « ne débouche sur de l’Autre, ne nous tourne vers un Être ou vers une Vérité », sans reconduire vers un plan « séparé d’elle, qui serait celui de l’idéel (spirituel) ou du symbolique – la grande image n’est pas le symbole se déployant en idée ».(xxxvii) L’image prend une forme concrète qui est particulière, et à ce titre, elle ne peut être « la grande image”, mais en même temps cette dernière n’est pas en mesure de se déployer « si des images particulières ne prennent pas forme. La grande image dépend de son actualisation dans des formes concrètes, mais il importe que ce concret ne la domine pas, que l’esprit ne se focalise pas sur la partialité de cette actualisation concrète ».(xxxviii)
Il n’est pas étonnant que le paysage, lieu par excellence de mise en oeuvre de la variance et du compossible, occupe une place déterminante chez Henri Barande. Encore faut-il, comme sa peinture nous y invite, élargir la notion même de paysage. Il y a chez lui un devenir portrait du paysage et un devenir paysage du portrait: paysages hantés, nous l’avons vu, par le reflet du spectateur ou l’ombre d’un regard filtre (Fig.2.2; Fig.2.14), crâne colossal exhibant la cartographie paysagère de ses sutures coronales (Fig.3.1), ligne d’horizon coïncidant avec le tracé fluide de portraits sans nom (Fig.1.19; Fig.3.2), profil féminin pulvérisé dans l’horizontalité d’un paysage entropique (Fig.3.3), portrait (celui d’Adèle Bloch-Bauer par Klimt) transfiguré en archipel d’ilôts irradiants (Fig.3.4; Fig.3.5).
Ailleurs, ses paysages semblent faits de la matière brute de la nature : force végétale se déployant par prolifération sur toute la surface du grand paysage rose et noir (Fig.3.6), force liquide animée de remous et de reflets assimilant la surface d’une toile horizontale aux tons bleutés à un paysage océanique (Fig.3.7): il y a chez Henri Barande un devenir abstrait du paysage et un devenir paysage des toiles non figuratives. « Paysages absolus » pourrait-on dire, où l’oeil n’est pas antérieur, source de vision, constructeur du visible mais « peut simplement recevoir ce que la nature présente ».(xxxix) Paysages sans détermination localisable comme les portraits sont sans nom. La présence d’un temple japonais peut bien fournir un indice, mais toujours l’indétermination l’emporte sur l’identification (Fig.3.8): au dédoublement symétrique du paysage et de son reflet à la surface de l’eau s’ajoute la solarisation de l’image inversant les valeurs d’ombre et de lumière, transformant le diurne en nocturne, installant le flou et le vague.
Devenir visage du paysage et devenir paysage du visage adviennent aussi dans la juxtaposition des images faisant oeuvrer conjointement variance, compossibilité et indétermination. Ainsi le couple d’un vaste paysage et d’un visage qui emprunte au premier son horizontalité, son ampleur et son intense vibration colorée. (Fig.3.9) À droite, le paysage, d’une lisière incertaine de forêt, épais rideau d’arbres qui déploie à nouveau, par variance, la vision obstruée de ses autres paysages, associant le flou au principe mosaïque de la fragmentation pointilliste. La terre, les arbres et le ciel y sont matérialisés par des taches de pigment rouge et bleu. Une grille régulière de taches rouges et luminescentes, comme de petites explosions pigmentaires, s’étire sur toute la surface elle-même criblée de tâches bleu pâle tout aussi éclatantes. (Fig.3.10) Il en résulte un effet d’indistinction entre le fond et la surface, le proche et le lointain, le plein et le vide, faisant osciller l’oeil entre l’image du paysage et la trame distendue dans laquelle elle se dissout. Paysage inchoatif, émergeant et disparaissant, surface indéterminée qui cependant existe pleinement comme paysage, image insaisissable dont la présence nous saisit. L’insaisissable nous saisit encore devant le portrait féminin sensuellement lié au paysage à gauche. (Fig.3.9) Quasi monochrome rouge où surgit pourtant le délicat tracé d’un visage, à peine perceptible, apparaissant et s’enfonçant à nouveau, au gré des déplacements et de la lumière, vers le fond d’une sombre luminescence. Il faudrait pour décrire la non séparation éprouvée ici entre l’image et le phénomène, se tourner encore vers l’esthétique chinoise qui désigne d’un même terme, autant nominal que verbal, la dimension imageante et l’avènement.(xl)
L’idée de « la grande image n’a pas de forme » implique non seulement la variance et le compossible, mais aussi la transition d’une figure à l’autre: le déroulement plus que l’arrêt, le processus plus que la création, ce qui n’a ni début, ni fin mais est toujours transition d’une forme à une autre, d’une aspectualisation à une autre.(xli) C’est la raison pour laquelle cette pensée attentive à la transformation, à ce qui est en cours, a privilégié le paysage et certaines de ses formes particulières. Paysages peints sur rouleaux où chaque moment qui se dévoile progressivement se rattache au moment précédent tout en ouvrant sur le suivant, où le vide partout présent assure le passage entre les formes, entre ce qui apparaît et ce qui disparaît. (xlii) Paysages du soir dans lequel la grande image à trouvé l’une de ses formes de prédilection (xliii): « quand au cours de cette autre transition, du jour à la nuit, les formes à la fois se nimbent et s’obscurcissent, et peu à peu deviennent indécises. Tandis que les vapeurs qui montent effacent les arêtes et que le paysage entier commence à plonger dans la pénombre, ces formes qui vont se confondant appellent à dépasser leurs individuations temporaires pour rejoindre le fonds indifférencié des choses. »(xliv) Paysages enfin de montagnes nimbées de nuages, saisis en suspens entre ce qui se forme et ce qui se déforme, entre ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas.(xlv) « La grande image est en essor et se maintient expansive : tout en se manifestant dans des formes concrètes, elle reste habitée de vague et de flou qui la déploient indéfiniment; en même temps qu’elle figure et fait voir tel aspect, elle contient en son fonds bien d’autres aspects possibles ; ou encore, en se réalisant en plein, elle demeure traversée de part en part par la vertu du vide (…) l’entrouvrant sur l’indifférencié. »(xlvi)
Dans l’oeuvre de Henri Barande, flou et indécision s’allient à la « vertu du vide » : vide interstitiel des « tesselles» dans les images mosaïques, vide qui enveloppe comme une buée les formes qui s’agrègent-se désagrègent en grains de couleurs, vide cernant les figures qui apparaissent-disparaissent, vide enfin qui sépare et relie en une ligne continue toutes les images. Le vide, à l’oeuvre dans l’intimité des choses (xlvii), les rendant incertaines et les ouvrant, est moins entité que « facteur opérant ».(xlviii) Il participe de façon dynamique à la logique de la variance et à la compossibilité mise en oeuvre par la tension mosaïcale entre la discontinuité des images singulières et fragmentaires et la continuité de la grande image en incessant devenir. Vide et transformation habitent chaque image – entraînée dans un même mouvement vers sa disparition et sa figurabilité selon les forces de l’indétermination et de l’inchoativité – et toutes les images, prises dans leur continuité, dans ce qui les lie ensemble.
« Dans la juxtaposition, dit l’artiste, les tableaux se lient autant qu’ils se délient: ils entrent en résonance, parfois se fuient avec horreur. Ce qui les oppose est la source inattendue de leur interaction, et leur abyssale séparation se nourrit du lien créé avant qu’il ne se déchire. Aucune place ne leur étant assignée, le nombre infini de leurs combinaisons est à la mesure du chaos induit de leur état d’impermanence. Au cœur de cet effondrement du symbolique apparaît la sublimation de la réalité, comme le seul moyen du retour : retour du monde d’avant, du désir éternellement inavoué du commencement, du monde précédant toute connaissance. »(xlix)
Sa peinture semble ainsi déployer un processus de réagencement inépuisable – les combinaisons impliquant plusieurs centaines de toiles étant infinies – ce qui ne veut pas dire effréné ou discordant. Paysages et visages apparaissant-disparaissant, objets énigmatiques et compositions abstraites, peintures anciennes et photographies: ses toiles se lient et se délient en une incessante juxtaposition où se « révèlent des dissonances et des accords, parfois incompatibles avec les lois de l’harmonie. » Mais, ajoute-t-il, « si l’on prolonge le moment de surprise, si l’on résiste au sentiment de bonheur, de tristesse ou de désolation que ne manque pas de produire la seule procession d’une multitude de contraires, une musique ne tarde pas à se faire entendre. »(l)
Ainsi, l’accord séquentiel et obsédant qui lie des restes humains à de vastes surfaces morcelées et abstraites. Un crâne coiffé de plumes amérindiennes jouxte le paysage absolu noir et rose. (Fig.3.11) La trace solarisée et spectrale d’un couple de squelettes en position fœtale (selon une conception de la mort comme renaissance) côtoie une monumentale surface envahie d’une neige noire. (Fig.3.12) Une tête embryonnaire évoquant un crâne jouxte une surface mosaïque morcelée. (Fig. 3.13) Plus loin l’image d’un crâne et celle d’un parallélépipède tombal agrandi à notre propre stature – deux images nous confrontant à la ressemblance et à l’absence – encadrent à nouveau une immense toile abstraite. (Fig.3.14) Image irreproductible – comme le sont toutes ses toiles qui exigent une relation perceptive directe – elle englobe par sa taille le champ de notre regard en le soumettant à l’effet d’une vibration, d’une pulsation intense, presque vertigineuse. L’oeil est happé par un réseau de figures géométriques qui, planes et régulières sur les côtés, se déforment progressivement, se plient vers le centre comme autour d’un invisible vortex. En même temps qu’elles se distendent jusqu’à l’informe, comme aspirées vers leur noyau pulvérisé au centre, les figures saturent la surface jusqu’aux limites de l’image qu’elles débordent. Paysage-oeil, centripète et centrifuge à la fois, sur le seuil de l’expansion et de la résorption. Image de régression entropique qui est aussi potentiel de mouvement et d’énergie.(li) Image abyssale et emblématique de cette pensée visuelle vouée à ce qui s’oppose et communie dans l’univers, tendue entre le commencement et l’achèvement, entre chaque image et la grande image:
« Leur communauté on l’indique en la disant abyssale.
Abyssale et toujours plus abyssale:
Telle est la porte par où passe en foule l’indéfiniment réussi. » (Laozi)(lii).
Michel Weemans
[i] Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964, pp. 92-93.
[ii] Pour reprendre le terme proposé par Gérard Wajcman : « …Les grandes oeuvres ne sont jamais achevées. Non parce qu’elles seraient non finies, mais parce que, même finies, elles s’emplissent des temps qu’elles traversent et se complètent à l’infini des interprétations toujours recommencées qu’elles suscitent ou engendrent ; même finies, les oeuvres sont manquantes, non pas incomplètes mais plutôt « décomplètes », d’une « décomplétude » essentielle et irrémédiable… », Gérard Wajcman, « Le regard de l’ange », Y voir mieux, y regarder de plus près : autour de Hubert Damisch, sous la dir. de Danièle Cohn, Paris, ENS, 2003, p. 188.
[iii] Henri Barande, Identification d’un absent. Entretien avec Romaric Sulger Büel, Manuela éditions, 2008, p. 14-15.
[iv] Henri Barande, Sublimation.
[v] Idem, p. 28.
[vi] Sur la pratique de l’autodestruction dans l’art moderne, voir notamment Dario Gamboni, La Destruction de l’art. Iconoclasme et vandalisme depuis la Révolution française, Dijon, Les presses du réel, 2016, en particulier pp. 380-397.
[vii] Cf. Derek Pullen, cité par David Galloway, in « A Reclusive Businessman’s 50-Year Passion: Sculptor’s Secret is Out”, The New York Times, 12 Août 2000.
[viii] Barande, Identification d’un absent. pp. 14-15.
[ix] Cf. Dario Gamboni, Potential Images: Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art, Londres, Reaktion Books, 2008; tr. Fr. : Images potentielles. Ambiguïté et indétermination dans l’art moderne, Dijon, Les presses du réel, 2016.
[x] Cf. Wittgenstein, Études préparatoires à la 2e partie des Recherches philosophiques, tr. fr. Gérard Granel, Mauvezin, TER, 1985, § 554.
[xi] Alberti, De statua, éd. Bätschmann, 2011, pp. 62-63. Sur l’image potentielle comme origine de l’art, cf. notamment Dario Gamboni, Images potentielles, chapitre « Mythes et traces d’origine”, pp. 44-50; Jean-Hubert Martin (sous la direction de), Une image peut en cacher une autre, catalogue d’exposition, Paris, Réunion des musées nationaux, chapitre « Mythes d’origine”, pp. 1-10.
[xii] Henri Michaux, Émergence-Résurgence, Genève, Skira, 1972, p. 14.
[xiii] Dans la tradition des têtes paysages néerlandaises des 16° et 17° siècle. Sur cette question, je me permets de renvoyer à Michel Weemans, Herri met de Bles. Les ruses du paysage au temps de Bruegel et d’Érasme, Paris, Hazan, 2013, notamment chap. VI, « Image double. Le paysage anthropomorphe à la Renaissance », pp. 171-203.
[xiv] Henri Barande, Identification d’un absent, p. 30.
[xv] Gaston Bachelard, L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Paris, Cortis, 1943, p. 20, cité par Gamboni, Images potentielles, p. 38.
[xvi] Cf. Gamboni, ibid., p. 37.
[xvii] Sur cette question, cf. Images doubles. Pièges et révélations du visible, sous la direction de Michel Weemans, Dario Gamboni, Jean-Hubert Martin, Paris, Hazan, 2016.
[xviii] Pour caractériser l’art de Gerard Fromanger. Cf. Michel Foucault, La peinture photogénique (1974), rééd. Paris, Le point du Jour, 2014.
[xix] Avant la peinture, la mosaïque était déjà présente dans les objets et les sculptures : un fragment de corail blanc et une dentelle métallique rouillée dont la texture s’apparente à la mosaïque. Un corps sculpté et fragmenté composé de précieuses tesselles rouges, figé dans un sarcophage cristallin de résine.
[xx] Valeur de durée exprimée par Stendhal affirmant que « la véritable peinture pour l’éternité, c’est la mosaïque », reprenant lui-même un topos qui remonte à Domenico Ghirlandaio « La vera pittura per l’eternità essere il mosaico. » Stendhal, Histoire de la peinture en Italie, t. I, 1817, p. 155. Cité par Lucien Dällenbach, Mosaïques. Un objet esthétique à rebondissements, Paris, Seuil, 2001, p. 43.
[xxi] Cf. Lucien Dällenbach, Mosaïques, p. 40.
[xxii] Sur cette définition structurelle de la mosaïque cf. Lucien Dällenbach, Mosaïques. Un objet esthétique à rebondissements, Paris, Seuil, 2001.
[xxiii] « Si un homme avait une vision si myope que, sur un pavement fait de très petits cubes, l’acuité de sa vision ne fût pas assez forte pour aller au-delà de la largeur d’un cube, il accuserait l’artisan d’ignorer la technique de mise en ordre en un tout, parce qu’il croirait qu’il a devant lui un mélange de pierres dépourvu d’ordre, faute de pouvoir discerner et saisir par la même opération, d’un coup d’œil, les différents panneaux qui se raccordent pour former une seule et belle image. » Saint Augustin, De ordine, cité par Lucien Dällenbach, Mosaïques, p. 75.
[xxiv] Cf. Dällenbach, Mosaïques, p. 41.
[xxv] Dans le cas des mosaïques de l’art nouveau, chez Gaudi, auxquels on pourrait associer de nombreuses peintures en mosaïque des tableaux damiers de Klee au Lincoln de Dali, des portraits mosaïques de Chuck Close jusqu’aux œuvres pixellisées de Gerhard Richter.
[xxvi] Que Dällenbach, citant Cézanne pour qui il s’agit « d’être peintre par les qualités mêmes de la peinture », analyse comme des entreprises-limites questionnant l’unité et la mimesis, valorisant l’incomplétude, mettant l’accent sur le fragment et la matérialité. Cf. Dällenbach, Mosaïques, pp. 90 sq.
[xxvii] Une réhabilitation qui a eu lieu parallèlement, comme le montre Dällenbach, chez les écrivains qui de Balzac à Apollinaire et à Claude Simon ont privilégié une écriture fragmentaire en tension avec une unité problématique, laissant place aux discontinuités et aux blancs qui brisant le fil causal ou discursif. Ainsi le témoignage de Gila Lustiger affirmant à propos de son roman L’inventaire, « Je ne voulais pas montrer ce qui existe mais ce qui n’existe pas, le vide, le manque (…) Si vous écrivez de manière linéaire le récit a une logique qui échappe à ce que vous voulez dire. Je suis donc pour casser. », cité par Dällenbach, Mosaïques, p. 67, note 34.
[xxviii] Dällenbach, Mosaïques, p. 56
[xxix] Envoyée par celui-ci à son père, communication orale de Henri Barande.
[xxx] Selon l’expression de Victor Stoïchita. Sur la figure-filtre et la question du regard entravé en peinture, cf. Victor Stoichita, L’effet Sherlock Holmes; variations du regard de Manet à Hitchcock, Paris, Hazan, 2015.
[xxxi] Je m’appuie ici principalement sur son livre La grande image n’a pas de forme. Ou du non-objet par la peinture, Paris, Seuil, 2003; ainsi que sur le chapitre intitulé “La grande image n’a pas de forme”, dans Le détour et l’accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce, Paris, Paris, Grasset, 1995, rééd. Le livre de poche, coll. Biblio essais, pp. 259-286, ainsi que sur ses très belles analyses consacrées à la peinture de paysage, notamment Vivre de paysage ou l’impensé de la Raison, Paris, Gallimard, 2014; Éloge de la fadeur. À partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine, Paris, Philippe Picquier, 1991, rééd. Le livre de poche, coll. Biblio essais. Sur la pensé hétérotopique de François Jullien comme pensée du détour, cf. notamment, François Jullien, Penser d’un dehors (la Chine), Paris, Seuil 2000; Oser construire pour François Jullien, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2007.
[xxxii] Une idée également formulée par Guo Xi, peintre lettré du XI° siècle, représentant d’une peinture qui déploie en les juxtaposant les aspects successifs d’un même paysage. Soit une montagne, écrit Guo Xi: « À considérer de près, c’est ainsi, à considérer de plus loin, c’est (différemment) ainsi, à considérer d’encore plus loin, c’est encore (différemment) ainsi. (…) C’est ce qu’on appelle la forme (actualisation) de la montagne, telle qu’on la voit de tous les côtés (…) tel est l’aspect d’une montagne, en même temps que de dizaines ou de centaines de montagnes.» Guo XI, « Peindre une grande montagne », cité par Jullien, p.? Et lorsqu’il ajoute que la montagne « est une grande chose », il faut comprendre, commente Jullien, que « grand » ne désigne pas la taille mais « la capacité à contenir tous les possibles sans s’enliser en aucun, sans se restreindre à la nature d’aucun. », cf. François Jullien, L’archipel des idées de François Jullien, p. 182.
[xxxiii] Sur les notions étroitement liées de variance et de compossibilité, cf. notamment François Jullien, La grande image n’a pas de forme, pp. 77 sq.; Le détour et l’accès, pp. 259-286; L’archipel des idées de François Jullien, Paris, Éditions de la maison ds sciences de l’homme, 2014, pp. 179-192; Vivre de paysage, pp. 61-87.
[xxxiv] « Grand », en ce sens, que ce soit à propos du tao ou de la grande image, signifie qui embrasse les divers possibles et contient en soi tous les angles de vue; grand signifie qui est ouvert à l’un comme à l’autre et n’exclut pas. (…) Grand, en somme, dit la plénitude du compossible (…) Parallèlement au « flou », qui disait l’indétermination du foncier, le « grand » du tao ou de la grande image dit ainsi la dé-termination qui embrasse le plus amplement les déterminations et les con-fond. » François Jullien, La grande image n’a pas de forme, pp. 87-88.
[xxxv] Sur le flou, cf. François Jullien, La grande image n’a pas de forme, chap. III, « Vague, terne, indistinct », pp. 55-75; ainsi que Michel Makarius, Une Histoire du flou, Paris, éditions du Félin, 2016.
[xxxvi] cf. François Jullien, La grande image n’a pas de forme, p. 143.
[xxxvii] Ibid. , p. 143.
[xxxviii] La condition de disponibilité et de compossibilité qui font la grande image est ce que désigne au mieux la « fadeur”. D’où la valorisation dans l’esthétique et dans la pensée chinoise de ce mot que la pensée occidentale comprend pour sa part négativement. Cf. François Jullien, Éloge de la fadeur, op. cit. Note 33.
[xxxix] Selon l’expression de Louis Marin, in « Les plaisirs du désert en peinture », Philippe de Champaigne ou la présence cachée, Paris, Hazan, 1995, pp. 30-75.
[xl] Sur le terme de che, cf. François Jullien, La propension des choses.
[xli] Cf. François Jullien, Procès ou Création. Une introduction à la pensée des lettrés chinois, Paris, Seuil, 1989.
[xlii] Sur les paysages en rouleau, cf. notamment Francois Jullien, Le détour et l’accès, pp. 327-330; La propension des choses, pp. 129-159.
[xliii] « S’héberger un soir au sein des brouillards (….) quand tout le paysage se perd dans la confusion: émergeant-immergeant, entre ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas – voila ce qu’il est difficile de figurer » (Qian Wenshi). François Jullien, Le nu impossible, Paris, Seuil, 2000, p. 54.
[xliv] François Jullien, La grande image n’a pas de forme, p. 20.
[xlv] C’est à la fois la transition entre le jour et la nuit et celle conjointe du solide et du liquide qui garantit au paysage sa valeur de compossibilité. « Montagne(s)-eau(x) » dit l’idéogramme que traduit le terme occidental de paysage. Cf. notamment François Jullien, Vivre de paysage, chap. II, « Montagne(s)-Eau(x) », pp. 39-60.
[xlvi] François Jullien, La grande image n’a pas de forme, p. 143.
[xlvii] cf. François Jullien, La grande image n’a pas de forme, p. 125.
[xlviii] « L’activité qui le définit est (et n’est que) de mettre en communication, désopacifier, traverser et porter plus loin ». Idem, p. 133.
[xlix] Henri Barande, Identification d’un absent, p. 42.
[l] Idem, p. 44.
[li] « Dans le chaotique gît l’attraît de l’inchoatif » écrit Michel Jeanneret à propos de la fascination pour l’indéterminé et le chaos à la Renaissance. Cf. Michel Jeanneret, Perpetuum mobile. Métamorphoses des corps et des oeuvres de Vinci à Montaigne, Paris, Macula, 1997, p. 93.
[lii] Cité par François Jullien, Le Détour et l’Accès, chap. XII: « La grande image n’a pas de forme », p. 268.